
CARICATURE DE MCKENNA : Une caricature de McKenna, le gardien de but bloquant les salaires.
Par le passé, les soins infirmiers étaient perçus comme un type de tâches domestiques exécutées au domicile du patient, tandis qu'au 20e siècle les infirmières travaillaient principalement dans les hôpitaux. Parallèlement, la prestation des soins infirmiers s'est transformée en une profession dotée de normes reconnues en matière d'éducation et exigeant que les personnes qui la pratiquaient soient enregistrées et immatriculées. Les soins infirmiers étaient et demeurent une profession très largement dominée par les femmes et demandaient autrefois de leur part de l'affection, un esprit de service, de la discipline et une subordination au corps médical. À mesure que les soins infirmiers se sont professionnalisés et que les infirmières ont assumé de nombreuses nouvelles tâches hautement techniques jusque-là accomplies par les médecins, elles ont commencé à se rendre compte à quel point leur travail était sous-évalué.
Les infirmières avaient déjà eu des affrontements avec le gouvernement auparavant, mais c'est en 1991 et 1992 que le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick traversa ses moments les plus difficiles à ce jour. Le gouvernement libéral de Frank McKenna annonça un gel des salaires des travailleurs du secteur public en avril 1991, quelques semaines après avoir signé une nouvelle convention collective avec les infirmières qui travaillaient dans la fonction publique (un groupe représentant les infirmières employées directement par le gouvernement, y compris les infirmières de la santé publique). Les infirmières étaient amèrement déçues du premier ministre McKenna, qui, lorsque son parti n'était pas au pouvoir, avait promis d'améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail.
En réponse, les syndicats du secteur public, dont la New Brunswick Teachers' Federation (Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick), l'Association des employés de la fonction publique du Nouveau-Brunswick et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), s'unirent en une coalition afin de collaborer en vue de s'opposer à ces politiques. La Coalition des employés du secteur public fit campagne pour amener le gouvernement à abandonner le gel des salaires, mais sans succès. De nombreuses manifestations eurent lieu, dont une qui rassembla 5,000 personnes devant l'édifice de l'Assemblée législative à Fredericton le 17 avril 1991. La Coalition parraina une campagne de relations publiques qui comprenait des conférences de presse ainsi que des publicités à la radio et dans les journaux, et qui visait à rallier l'opinion publique de son côté en affirmant que le gouvernement avait manqué à sa parole en refusant d'honorer des contrats signés.
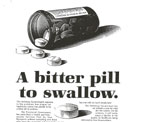
PUBLICITÉ DU SIINB : « A BITTER PILL TO SWALLOW » (UNE PILULE DIFFICILE À AVALER) : Une des publicités diffusée dans les journaux de langue anglaise dans le cadre de la campagne de relations publiques du SIINB.
Si les faits survenus sont de portée locale, ils s'inscrivent dans un contexte plus large. En raison des crises économiques des années 1970 et des taux d'intérêt particulièrement élevés des années 1980, les gouvernements canadiens étaient aux prises avec des récessions récurrentes qui les incitèrent à s'en prendre aux travailleurs du secteur public, à leurs salaires et à leurs syndicats. Le gouvernement fédéral favorisa les réductions des dépenses publiques, c'est-à-dire qu'il diminua les fonds qu'il versait aux provinces pour les soins de santé. Ainsi, il devenait de plus en plus difficile pour les gouvernements provinciaux de combler la différence.
Bien qu'ayant proposé le gel salarial pour un an, le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonça l'adoption de nouvelles compressions au début de 1992 et offrit aux syndicats du secteur public de jouer un rôle dans la mise en œuvre des réductions de 100 millions de dollars dans la fonction publique. Si les syndicats refusaient de participer, le gouvernement prolongerait le gel des salaires. Les infirmières et le SCFP refusèrent de participer aux compressions. Le SIINB lança une campagne publicitaire en février 1992 afin de gagner l'appui du public dans sa lutte contre de nouvelles réductions budgétaires. L'une des publicités affirmait que les politiques du gouvernement McKenna, qui avait omis de consulter le public et le secteur des soins de santé, étaient une « pilule difficile à avaler » . Le mouvement prit de l'ampleur dans les rangs du SCFP et du SIINB pendant les premiers mois de 1992, et bon nombre de leurs membres se préparèrent à déclencher la grève. Le 1er avril, des citoyens et des citoyennes des régions rurales du Nouveau-Brunswick envahirent littéralement l'Assemblée législative et réclamèrent une rencontre avec le premier ministre. Avant les élections de l'automne de 1991, qui avaient reporté le gouvernement McKenna au pouvoir, les travailleurs de la fonction publique avaient déclaré : « On ne peut pas faire confiance au gouvernement McKenna. Nous nous en souviendrons. »
Après que 70 % des membres du SIINB eurent voté en faveur d'une mesure de grève à la suite d'un vote semblable tenu par les membres du SCFP, le gouvernement provincial déposa des plaintes contre le SCFP et le SIINB pour avoir violé un article de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui portait sur les grèves illégales. Et ce ne sont pas toutes les infirmières, en effet, qui désiraient la grève; dans une entrevue réalisée à St. Stephen, trois infirmières s'exprimèrent franchement, et l'une d'elles déclara : « Les infirmières ne vont pas en grève [...] nous ne sommes pas un groupe de militants. Nous n'avons jamais fait une chose pareille dans le passé et nous n'aimons pas faire ça. » Ce n'était pas une question d'argent, dirent-elles, mais une question de négocier de bonne foi.
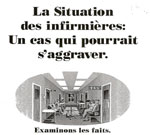
PUBLICITÉ DU SIINB : « LA SITUATION DES INFIRMIÈRES : UN CAS QUI POURRAIT S'AGGRAVER » : DESC.
Le gouvernement brandit des menaces d'amendes et de poursuites en justice, mais désigna le professeur de la University of New Brunswick et médiateur Tom Kuttner le 27 mai pour tenter d'en arriver à une entente. Après de longues et nombreuses heures, les deux parties conclurent enfin une entente le 30 mai. Le SIINB réussit à assurer que le contrat des infirmières soit respecté, en acceptant que les augmentations de salaires soient reportées jusqu'à la fin du contrat. L'entente conclue avec les infirmières ne comprenait pas le SCFP, ce qui causa des frictions entre les deux syndicats. Plus tard, le SCFP alla de l'avant avec le déclenchement d'une grève illégale qui prit fin le 15 juin. Malgré sa signature par près de 67 % des membres du SIINB, l'entente conclue par voie de médiation suscita une certaine opposition, notamment à Moncton, à Chatham et à Saint John. Linda Silas Martin, présidente du syndicat, écrivit à ses membres qu'il n'avait « pas été facile » pour la direction et le conseil exécutif « de prendre la décision de soumettre l'entente globale pour ratification. Toutefois, nous avons jugé que cette entente était absolument la meilleure que nous pouvions obtenir, et il aurait été imprudent d'inciter les infirmières à déclencher une grève illégale alors que cette offre était sur la table. »
Les remous entourant les gels salariaux et le respect de contrats conclus avec les syndicats eurent une grande influence sur les infirmières et leur compréhension de la négociation collective. En 1991, Linda Silas Martin avait écrit que les infirmières étaient plus mobilisées que jamais devant les événements : « Des infirmières qui n'avaient jamais pris part aux activités du syndicat commencèrent à venir aux réunions syndicales, à me téléphoner personnellement, à rédiger des lettres au courrier des lecteurs de leur journal, à avoir des rencontres avec leur président local, à rencontrer les députés provinciaux et à manifester partout dans la province. Les infirmières sont mécontentes. Elles se sentent trahies par le gouvernement. » Au sujet des luttes de 1991-1992, Debbie McGraw, qui a été présidente du syndicat de 2000 à 2004, affirma que « tout au long de cette période, de nombreuses infirmières prirent conscience du fait qu'elles formaient un syndicat et qu'elles formaient un syndicat puissant » . Marilyn Quinn, présidente actuelle du SIINB, a rappelé que « les infirmières étaient indignées qu'on les traite de cette façon, que le gouvernement provincial ait le pouvoir de vous donner quelque chose un jour et de vous l'enlever le lendemain [...] Cet épisode a eu pour effet de vraiment faire grandir le syndicat. »
Pendant très longtemps, les infirmières ont éprouvé un sentiment de tiraillement entre leur statut de professionnelles et celui de syndiquées, mais leur affrontement avec le gouvernement McKenna marqua un jalon important dans l'histoire des infirmières et l'évolution de leur identité en tant que membres d'un syndicat. Leur alliance avec d'autres syndicats au sein d'une coalition pour s'opposer au gel des salaires et leur message stratégique soulignant comment le gouvernement avait rompu des contrats signés s'appuyaient sur des thèmes plus larges et des problèmes récurrents : l'érosion des soins aux patients provoquée par la restructuration du système de soins de santé, le lien entre les soins aux patients et les conditions de travail des infirmières, et les promesses d'améliorer les salaires et les conditions de travail des infirmières, répétées pendant des décennies. En ces temps de crise et d'affrontement, la mémoire collective joua un rôle de premier plan dans la mobilisation des infirmières et des infirmiers.